Diffusions passées:

L’homme qui répare les femmes, La colère d’Hippocrate, diffusion du mardi 15 janvier 2019 à 02h55
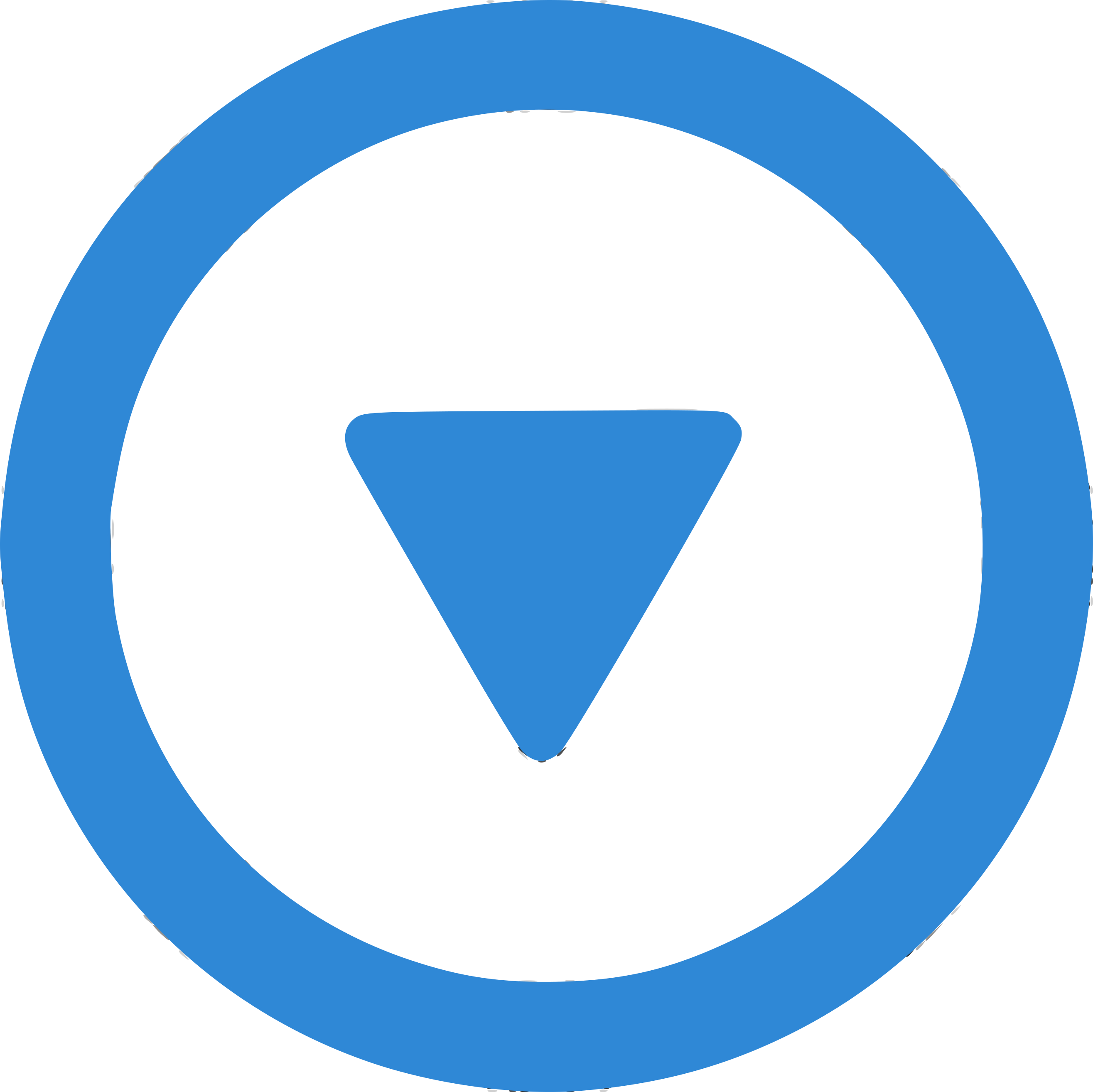
Denis Mukwege est surnommé «l'homme qui répare les femmes». Né en mars 1955 à Bukavu, dans le Congo belge, il y fait aussi ses études, et décroche son diplôme de biochimie en 1974. Il s'inscrit ensuite en médecine et se spécialise en gynécologie à l'université d'Angers, en France. En 1989, il retourne dans son pays natal pour s'occuper de l'hôpital de Lemera, dont il devient directeur. Après la Première Guerre du Congo, en 1996, il découvre les actes de destruction volontaire et planifiée des organes génitaux féminins. Il expose au monde entier la barbarie dont sont victimes les femmes de l'Est du pays et les prend médicalement en charge. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Critique : Sa voix d’ordinaire douce semble se lézarder sous la rage. Voilà près de vingt ans que Denis Mukwege opère sans discontinuer femmes et fillettes victimes de viols et de mutilations atroces, perpétrés par les milices ou par l’armée régulière dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Mais là, dans le bloc de son hôpital de Panzi, à Bukavu, l’examen clinique d’une jeune fille, le constat d’une énième lésion, d’une énième déchirure de la cloison rectale lui arrachent un feulement farouche. « Sa vie est fichue. S’il n’y a pas de mobilisation de la population, rien ne changera. » Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit 2014, et désormais Prix Nobel de la paix (1) , le gynécologue congolais a beau se saisir de toutes les tribunes pour dénoncer « ce fléau qu’est le viol utilisé comme arme de guerre », les victimes continuent d’affluer à Panzi. En cause, l’impunité dont bénéficient depuis vingt ans soudards hutus, tutsis et congolais. Au point que le viol s’est banalisé, y compris hors des zones de conflit, et concerne de plus en plus de très jeunes enfants, voire des bébés. Réalisé par deux arpenteurs affûtés du continent africain — la reporter du Soir de Bruxelles Colette Braeckman et l’indomptable « cauchemar » des autorités de RDC, Thierry Michel (2) — le film, sublimé par la photogénie du Kivu, prend le pouls d’une métamorphose. Lassé par tant d’immobilisme en dépit de ses appels, le héraut de la tragédie sanitaire annoncée se mue en pourfendeur du machisme social, de la corruption du pouvoir. N’abandonnant pas, pour autant, le lent travail de reconstruction des femmes que le film capte au fil de longues séquences incroyables d’empathie. (1) Colauréat avec Nadia Murad. Leurs prix leur ont été remis aujourd’hui à 13 heures à Oslo. (2) Son précédent film, L’Affaire Chebeya, un crime d’Etat ?, lui a valu une arrestation et une expulsion.

L’homme qui répare les femmes, La colère d’Hippocrate, diffusion du dimanche 09 décembre 2018 à 23h00
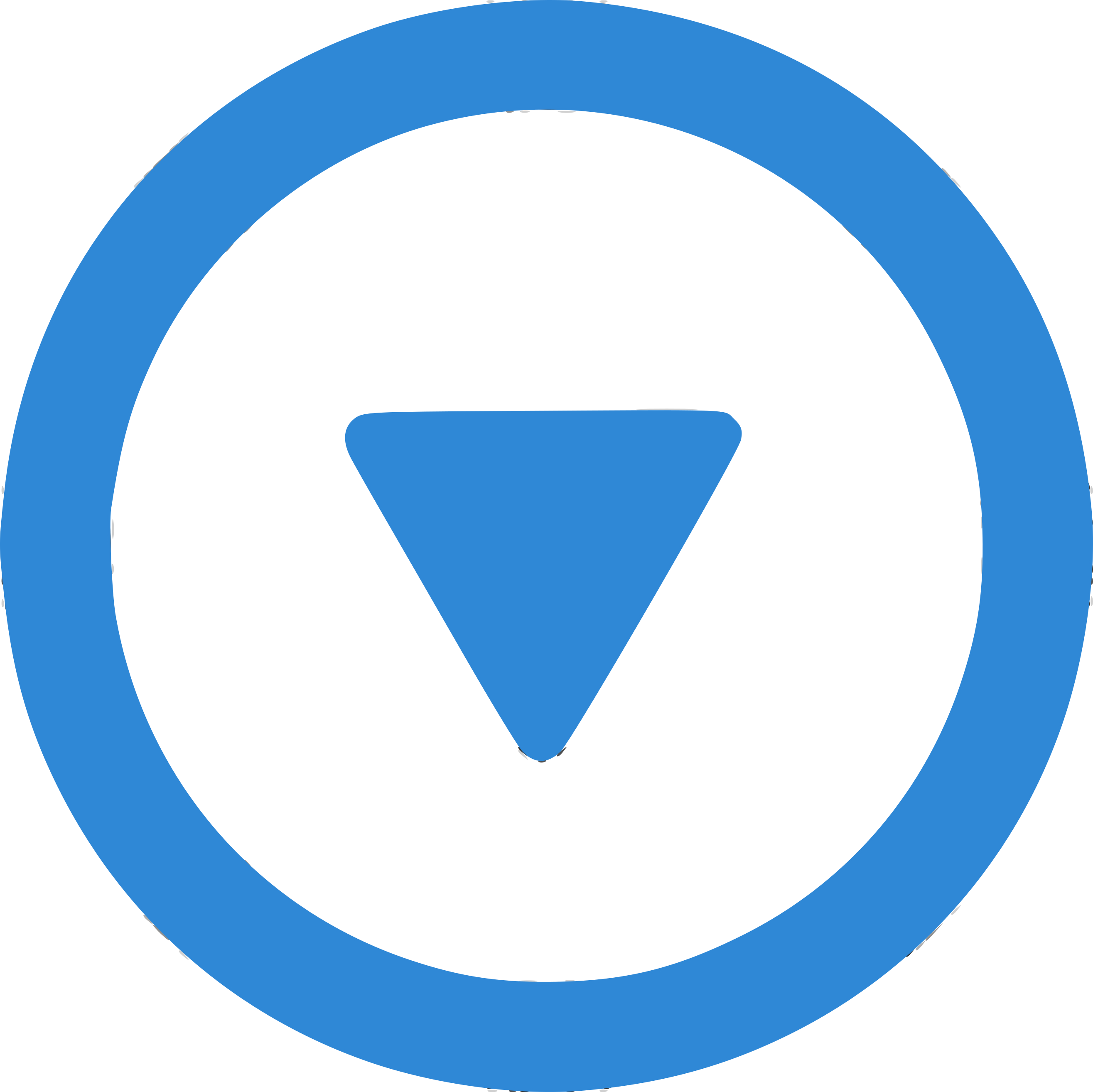
Denis Mukwege est surnommé «l'homme qui répare les femmes». Né en mars 1955 à Bukavu, dans le Congo belge, il y fait aussi ses études, et décroche son diplôme de biochimie en 1974. Il s'inscrit ensuite en médecine et se spécialise en gynécologie à l'université d'Angers, en France. En 1989, il retourne dans son pays natal pour s'occuper de l'hôpital de Lemera, dont il devient directeur. Après la Première Guerre du Congo, en 1996, il découvre les actes de destruction volontaire et planifiée des organes génitaux féminins. Il expose au monde entier la barbarie dont sont victimes les femmes de l'Est du pays et les prend médicalement en charge. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Critique : Sa voix d'ordinaire douce semble se lézarder sous la rage. Voilà seize ans que Denis Mukwege opère sans discontinuer femmes et fillettes victimes de viols et de mutilations atroces, perpétrés par les milices ou par l'armée régulière dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Mais là, dans le bloc de son hôpital de Panzi, à Bukavu, l'examen clinique d'une jeune fille, le constat d'une énième lésion, d'une énième déchirure de la cloison rectale lui arrachent un feulement farouche. « Sa vie est fichue. S'il n'y a pas de mobilisation de la population, rien ne changera. » Récompensé du prix Sakharov pour la liberté de penser 2014, le gynécologue congolais a beau se saisir de toutes les tribunes pour dénoncer « ce fléau qu'est le viol utilisé comme arme de guerre », les victimes continuent d'affluer à Panzi. En cause, l'impunité dont bénéficient depuis vingt ans soudards hutu, tutsi et congolais. Au point que le viol s'est banalisé, y compris hors des zones de conflit, et concerne de plus en plus de très jeunes enfants, voire des bébés. Réalisé par deux arpenteurs affûtés du continent africain, le film est plus politique que l'émouvant portrait proposé par Angèle Diabang en 2014, Congo, un médecin pour sauver les femmes. Fruit de l'expertise acérée de la reporter du Soir de Bruxelles et de l'insoumission infatigable du « cauchemar » des autorités de RDC (1) , le documentaire prend le pouls d'une mue. Celle de Denis Mukwege, de héraut de la tragédie annoncée en pourfendeur du machisme social, de la corruption du pouvoir. Lassé de tant d'immobilisme en dépit de ses appels, le docteur met désormais le doigt là où ça pue. N'abandonnant pas, pour autant, le lent travail de reconstruction des femmes que le film capte au fil de longues séquences incroyables d'empathie. — Marie Cailletet Une version longue est sortie en salles sous le titre L'homme qui répare les femmes. (1) Le précédent film de Thierry Michel, L'Affaire Chebeya, un crime d'Etat ?, lui a valu une arrestation et une expulsion.

